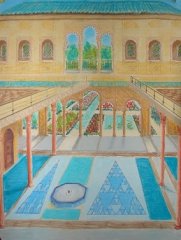 Eléments de prosodie
Eléments de prosodie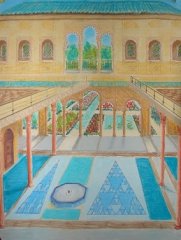
De Verlaine, nous savons qu’il faut choisir l’impair qui rend plus fluide le vers, mais au-delà de ce parti-pris en partie justifié, nous pouvons préciser ce qu’il en est du vers et de la rime et que de la structure au vers libre, encore que pour celui-ci, est-ce bien tout à fait le chaos ?, car n’est-il pas le reflet de notre pensée qui n’est pas vraiment chaotique. Il y a donc un grand chemin à parcourir qui n’oppose pas les deux. Remarquez que dans tout ce que j’envisage je ne tiens jamais compte de la diérèse afin de me cantonner au langage courant à moins que celle-ci en fasse partie, la diérèse choquant plutôt l’oreille de nos jours. Les termes de stabilité, symétrie et équilibre sont équivalents, ils sont liés à 2, 4, 8, 16...où la stabilité augmente avec le nombre. Dans la suite nous dirons pour 2 : stabilité faible, pour 4 : stabilité moyenne, pour 8 : stabilité forte. Les termes d’instabilité, de dissymétrie (asymétrie), de déséquilibre et de mouvement également, ils sont liés à 3, 5, 7, 11, 13... où l’instabilité diminue avec le nombre. Dans la suite nous dirons pour 7 : instabilité faible, pour 5 : instabilité moyenne, pour 3 : instabilité forte. Tout est fait dans le langage le plus simple, l’essentiel étant de bien comprendre mon propos. Notons que la question du rythme est encore autre chose qu’il faudrait étudier en relation avec ce qui suit.
- Le vers et la strophe.
- Stabilité, équilibre, symétrie.
Un, deux
un, deux
le pas
de deux.
Voyez-vous c’est déjà stable avec la symétrie de ses vers et de ses strophes.
Le cas de quatre :Un, deux ; trois, quatre
un, deux ; trois, quatre
un, deux ; trois, quatre
un, deux ; trois, quatre
de l’éléphant
n’entendons pas
si pesamment
le très lourd pas
mais en deux strophes
ne suffit pas
elle s’étoffe
tel un sherpa
du poids si lourd
du havresac
et d’un bruit sourd
com’ tac au tac.
Mais ici n’est-ce pas encore plus stable ? Alors bien sûr, quelques remarques s’imposent. Les quatre premiers vers sont particulièrement équilibrés, non pas comme les trois suivants. Donc si nous voulons jouer la stabilité, il y faudrait introduire des vers avec une césure, c'est-à-dire deux fois deux syllabes. Et ici je ne traite pas des rimes, bien que j’aie pris ABAB qui donne une certaine stabilité.
Passons à l'octosyllabe:Un, deux ; trois, quat’. Cinq, six ; sept, huit
et là nous ne pouvons lever
les pieds et ne sommes enfuis
vu que la glais’ nous a scotché.
Est-ce ainsi qu’il faut comprendre
qu’avec ces vers n’avons perdu
espoir et là lever , attendre
dernier verre et enfin pendu.
Voilà une strophe de huit octosyllabes parfaitement équilibrés car de la forme 2+2+2+2 syllabes. Alors bien sûr, il faudrait huit strophes de ce genre, mais quelle lourdeur ! Pour alléger tout cela, il faudrait peut-être se contenter de la forme 4+4 qui laisse un peu plus de liberté, laissant la place à 1+3 ou 2+2 ou 3+1 pour le demi vers. Ce qui est fait pour le cas quatre est nettement plus léger étant dû au fait que c’est quatre et non huit. Je ne traite pas du vers de seize syllabes et ainsi de suite, qui seraient encore plus pesants.
Pour ce qui est des strophes, celles de deux vers, de quatre vers, de huit vers etc…, donnent encore plus de stabilité. Ce que nous pouvons combiner avec deux strophes, quatre strophes, etc... - Instabilité, dissymétrie, mouvement.
Le cas de trois :
Un, deux, trois.
un, deux, trois.
un, deux, trois.
.
avançons.
comme en transe.
et tournons.
.
un, deux, trois.
c’est la danse.
entraînante..
Voyez là, vu le rythme j’en ai perdu la rime. Est-ce qu’il y a besoin de commentaires ? C’est le mouvement et le plus rapide, mais voyons pour cinq.
Le cas de cinq :Un, deux, trois, quatre, cinq
c’est un peu plus lent
mais c’est tout de même
la fêt’ au pas de
cinq qui est d’la danse.
Ici nous avons une structure 1+1+1+1+1 qui est la seule façon d’avoir un pur mouvement et je n’y ai pas mis de rime pour ne pas le casser ; enfin il y aura ici à préciser. C’est un peu moins dynamique que dans le cas de trois, n’est-ce pas ? Si vous mettez 1+4, 2+3, 3+2, 4+1 ou 2+2+1 vous introduisez de l’équilibre. Notez aussi, que pour être complet j’aurai du écrire cinq strophes. Nous pouvons faire de même avec 7, 11, 13 …qui sont des mouvements de plus en plus lents.
- Les différents vers.
Pour les vers de 2, 4, 8…syllabes et ceux de 3, 5, 7, 11, 13…syllabes nous avons réglé la question.
Vers de six syllabes : 1+5 ou 5+1 : finalement c’est deux parties de mouvement, donc stabilité d’instabilités.
2+4 ou 4+2 : c’est deux parties de stabilité mais inégales donc de l’instabilité de stabilité.
2+2+2 : la c’est de l’instabilité de stabilités.
3+3 : c’est une structure stable d’instabilités.
Vers de neuf syllabes :
2+7 ou 7+2 : mélange de stabilité et d’instabilité.
3+6 ou 6+3 : c’est complexe, voir pour six syllabes et trois et on ajoute de la stabilité en coupant en deux mais quand même les deux parties sont inégales donc déséquilibrées.
3+3+3 : du pur mouvement : instabilité d’instabilité.
4+5 ou 5+4 : une stabilité d’une stabilité ajoutée à une instabilité.
Vers de dix syllabes :
5+5 : stabilité d’instabilités.
4+6 ou 6+4 : voir ce qui précède.
3+7 ou 7+3 : stabilité d’instabilités.
2+8 ou 8+2 : stabilité de stabilités, une légère et une plus lourde. Donc cependant une dissymétrie (le plateau de la balance penche).
Vers de douze syllabes :
6+6 : voir ce qui précède stabilité d’un objet plus complexe.
4*3 : stabilité d’instabilités.
3*4 : instabilité de stabilités.
5+7 ou 7+5 : stabilité d’instabilités avec cependant une dissymétrie. - Structures et chaos ou aléa.
Entre aléa, stabilité et instabilité, l’on peut faire toutes les combinaisons possibles ; là c’est tout un art car c’est en fonction de ce que l’on veut exprimer : de la stabilité, de l’instabilité ou un peu de chaos. Par exemple on peut avoir des structures d’aléas ou des aléas de structures (aléa + aléa ou aléatoirement des longueurs de deux syllabes et trois quatre syllabes par exemple). Idem avec aléas et instabilités.
- Stabilité, équilibre, symétrie.
- Rimes
Le cas deux : AA BB ou AB AB ou AB BA. Il y a là de la symétrie donc de la stabilité. Nous retrouvons en fait le cas des rimes plates, embrassées ou croisées.
Le cas trois : AAA BBB CCC ou ABC ABC ABC. Nous gardons l’instabilité donc le mouvement du cas trois. Pour mélanger stabilité et instabilité nous avons ce qui suit.
Ou un mélange des deux : AAB BBC CCA ou ABA BCB ACC
Ou avec de l’aléa : ABA CBB CAC ou AAB BCB CAC
Le cas quatre :AAAA BBBB CCCC DDDD ou AABB BBCC CCDD DDAA ou
ABBA BCCB CDDC DAAD pour lesquels nous avons gardé de la stabilité.
Par contre ABCD ABCD ABCD ABCD c’est de l’instabilité.
Avec un mélange : AACB BBDA CCAB DDCD.
Avec de l’aléa : ABAD BCDA BACD CBCD qui est une stabilité, celle du cas 4, d’aléas.
Nous pourrions continuer ainsi. Nous voyons que la rime classique introduit le cas deux de façon systématique. J’espère qu’ainsi que je l’expose un nouvel essor de la rime est ainsi possible en en multipliant les effets.
Remarquez que pour garder la stabilité j’ai pris AA, AAAA et pour de l’instabilité j’ai pris AAA mais que l’on pourrait prendre aussi AAAAA et ainsi de suite. En conclusion à contrario de la tradition il n’est pas nécessaire de faire rimer les vers par deux, mais aussi par 3, 4, 5 …
L’on peut aussi jouer sur les rimes féminines et masculines.
- Strophes
Jusque là j’ai pris des strophes de longueur adaptée aux vers, mais l’on peut aussi jouer sur la longueur de celles-ci et leur nombre, sachant toujours appliquer stabilité, instabilité et aléas à ces longueurs. Nous pourrions passer à l’étude des agencements classiques quand ils ont une structure, mais il est toujours possible d’en créer d’autres sur les principes indiqués. La richesse est infinie.
L'on peut ainsi examiner, sous la lumière de ces constatations les formes traditionnells de la poésie, ce que je ne fais pas ici.
